La 30e Conférence des Nations unies sur le climat s’ouvrira officiellement lundi 10, à Belém, aux portes de l’Amazonie brésilienne. 143 délégations sont accréditées, sur 197 États membres de l’ONU climat. Prélude à cette COP30, ce jeudi et vendredi, les chefs d’État sont attendus pour envoyer des messages forts alors que les émissions mondiales de gaz à effet de serre augmentent toujours et que l’argent manque au Sud pour qu’il opère sa transition énergétique et se prépare aux changements.
Décriées, à tort et à raison, pour leur inefficience face à l’urgence, les COP des Nations unies restent tout de même le seul moment politique au monde – exception faite de l’Assemblée générale – où tous les États sont représentés et où chacun a voix au chapitre. La 30e du nom s’ouvre le 10 novembre à Belém, ville pauvre de l’État du Para, le plus déboisé du Brésil.
Si aucun sujet emblématique ne se démarque de l’agenda de négociations, cette COP reste charnière et symbolique. Notamment parce qu’elle se tient dix ans après l’Accord de Paris, le texte universel qui sert de cadre à l’action climatique.
Elle a pour mission de faire collaborer les pays dans la lutte commune contre le réchauffement du climat. Tous ont des responsabilités très différentes dans son origine et des capacités inégales à affronter ses effets, plus fréquents et plus intenses. L’ouragan Melissa en est une nouvelle illustration : le phénomène le plus puissant ayant frappé une île de l’Atlantique laisse dans son sillon près de 60 morts et des îles caraïbéennes exsangues.
Cet ouragan reviendra certainement dans la bouche de nombreux dirigeants ce jeudi et vendredi. Une petite soixantaine de chefs d’État et de gouvernement est attendue à la tribune du Parque de Cidade.
Tour à tour, ils donneront le ton de leurs attentes et de leurs priorités. La présidence de la COP attend beaucoup de ce « Global Mutirão », l’expression maintes fois répétée qui désigne un moment d’action et d’entraide chez les communautés autochtones de la forêt amazonienne. « Nous avons les solutions, nous avons l’engagement. Il est temps que le débat et l’action climatiques sortent des salles de négociation », affirmait vendredi dernier Tulio Andrade, le directeur stratégique de la COP30 lors d’une conférence de presse.
La COP30 ouvre un nouveau cycle pour « l’ambition climatique ». Comme exigé par l’Accord de Paris, les États devaient déposer leurs nouvelles politiques climatiques, ou Contributions déterminées au niveau national (NDC), à horizon 2035. L’ensemble des nouvelles NDC pour limiter les rejets carbonés conduisent à un réchauffement de 2,3°C à 2,5°C d’ici la fin du siècle, et même 2,8°C si les politiques actuelles se poursuivaient. Ce n’est pas noir. En 2015, les scientifiques projetaient pour 2100 un scénario apocalyptique de +4 à +5°C de réchauffement. « L’Accord de Paris fonctionne, on voit une inflexion de la trajectoire », assure Gaïa Febvre, responsable des politiques internationales au Réseau action climat (RAC), en écho à d’autres experts. « Mais ce n’est toujours pas assez pour rester sur une planète viable. »
Et pour cause : « Les nouvelles NDC ne contribuent guère aux progrès », parce que la baisse d’émissions ne serait que de 10% d’ici à 2035 par rapport à 2019 alors qu’il faudrait les abattre de 60% pour remplir le premier objectif de l’Accord de Paris : contenir le réchauffement climatique mondial « bien en-dessous 2°C » et de « poursuivre les efforts pour le limiter à 1,5°C » par rapport à l’ère préindustrielle.
En résumé : la théorie est là, mais l’action ne va pas assez vite, malgré le déploiement massif des énergies renouvelables. « Nous ne parviendrons pas à contenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5 °C dans les prochaines années », reconnaissait même pour la première fois Antonio Guterres, quelques jours avant l’ouverture de la COP. Avec des « conséquences dévastatrices » pour nombre de pays où les températures dépassent parfois les 50°C et où la mer submerge les côtes, salinise les cultures dans les régions de delta.
Dans ce contexte, la position européenne est très commentée. Les Vingt-Sept ont failli manquer à l’appel de l’ambition climatique. L’UE, qui est la seule grande puissance à avoir baissé ses émissions l’an dernier, tient un rôle de meneur dans les négociations climatiques. Elle arrive cette fois déchirée, bloquée par des pays conservateurs, rejoints depuis cet été par la France. Paris multiplie les reculs environnementaux, 43 en six mois précisément selon le RAC, reflet d’une lame de fond plus générale. Lors d’une réunion de la dernière chance, les ministres de l’Environnement ne sont pas parvenus à s’entendre sur un objectif précis pour 2035. Bruxelles arrive à la COP avec un plan climat amoindri, rendu in extremis, et présentera une fourchette de 66,25% à 72,5% de réduction des émissions. « Même la limite supérieure de cette fourchette est incompatible avec une trajectoire crédible vers la réduction de 90 % proposée pour 2040 », a réagi Greenpeace.
D’autres, comme l’envoyée spéciale pour l’Europe auprès de la présidence de la COP Laurence Tubiana, se félicitent que « l’Europe arrive à Belém avec une NDC forte ». Mais « l’architecte » de l’Accord de Paris regrette « le jeu de moins-disant ». « Tout signal de doutes et de reculs est négatif. » « L’UE n’est plus du tout dans une position de leadership, quoi qu’elle clame », cinglait Rebecca Thissen, responsable du plaidoyer mondial du Réseau Action Climat international.
Cette COP sera-t-elle sans champion de l’ambition, laissée à la merci du camp de la stagnation, du recul, voire du déni ? Le contexte géopolitique n’est pas favorable à des progrès sur le front du climat, alors que l’urgence le commande. L’administration Trump, qui rejette tout dialogue multilatéral, n’enverra pas de représentant de haut-niveau. Ce qui ne veut pas dire qu’elle n’agira pas en sous-main. Mi-octobre, elle a réussi à repousser l’adoption d’un accord majeur sur la décarbonation du transport maritime. « La stratégie de gros durs qu’ils ont employée à Londres [siège de l’Organisation maritime internationale] pourrait bien se reproduire à Belém, craint Rebecca Thissen. Ils mettent sous pression les pays avec lesquels ils ont des accords bilatéraux en les poussant à se rallier à leurs intérêts. »
Pour Sébastien Treyer, directeur du cercle de réflexion Iddri, c’est la transformation des économies qui, elle-même, contribue à tendre les relations entre Etats. « Le déploiement extrêmement rapide des technologies chinoises électriques et les énergies renouvelables sont en train de révolutionner la plupart des relations commerciales entre les pays. C’est ça qui crée beaucoup de tensions », démêle-t-il. Désormais, les plans climatiques deviennent de vraies stratégies économiques. Le problème c’est qu’elles ne sont pas coordonnées, elles sont en compétition. » Il note un « besoin de signes d’apaisement et de coopération demandés tant par les Européens que par les Chinois, en matière de climat comme de commerce et d’investissement. Un scénario de coopération demande de se coordonner sur les politiques industrielles plutôt que de les confronter. C’est beaucoup mieux pour le climat. »
La diplomatie brésilienne a hissé « le renforcement du multilatéralisme » au top de ses priorités. Elle compte encourager les solutions et coalitions qui existent hors des négociations : contre la déforestation, pour quadrupler le développement des renouvelables, pour la réduction des émissions de méthane, pour promouvoir les opportunités de l’économie bas-carbone, ou encore aussi les controversés biocarburants.
Le Brésil ramène la COP à la maison
Quel pays plus emblématique que le Brésil pouvait accueillir ce moment charnière qui prétend « accélérer la mise en œuvre » des actions promises, COP après COP ?
Le géant sud-américain possède 60% de la forêt amazonienne, qui a été amputée d’une surface grande comme l’Espagne en quarante ans pour cultiver et faire pâturer de manière extensive. Sa conservation sera au cœur de la « COP des forêts » et du fonds de défense des forêts tropicales (TFFF) que le président Lula officialisera ce jeudi et dont il compte faire l’héritage concret de cette COP – en prévision, peut-être, de progrès tangibles dans l’arène des négociations.
Ses forêts primaires luxuriantes sont un havre de biodiversité et d’écosystèmes uniques. Cet environnement est aussi l’espace vital de 400 peuples autochtones. Une caravane fluviale, partie le 16 octobre d’Equateur, ralliera Belém dimanche, après un périple de 3000 km. La coalition « La Réponse, c’est nous », composée des leaders des peuples autochtones des neuf pays du bassin amazonien, revendiquera, lors d’un Sommet des peuples (12-16 novembre), une place officielle à la table des négociations.
« Avec plus de 3 000 représentants, cela devrait être la plus large participation autochtone de l’histoire des COP », explique Richard Klein, du Stockholm Environment Institute. « De nombreux chefs autochtones ont fait valoir que cette visibilité devait se traduire en un véritable pouvoir de décision et un accès direct au financement. » Des annonces sont attendues sur ces deux aspects ce jeudi de la part d’une douzaine de pays, dont la Norvège, l’Allemagne et le Royaume-Uni.
Le Brésil fut, en 1992, l’hôte du fondateur Sommet de la Terre de Rio, grand moment alternatif pour les mouvements alternatifs et sociaux et année de naissance des COP. Trente-trois ans après, alors que les inégalités économiques explosent, l’enjeu fort de cette « COP des peuples autochtones » sera de s’assurer que la « transition énergétique hors des combustibles fossiles » soit « juste », « ordonnée » et « équitable », comme demandé dans l’accord trouvé en 2023 à Dubaï (Bilan mondial). Que, par exemple, l’accès aux minerais critiques de la transition profite à toutes les sociétés sans reproduire les schémas de spoliation de terres ni aggraver les inégalités. Que l’exploitation industrielle des terres indigènes exclut tout projet extractiviste ou de plantation de monocultures. La COP30 aura pour tâche de dresser une feuille de route pour répondre à ce défi. Ce sera aussi le cheval de bataille des ONG qui réclameront l’établissement d’un mécanisme international pour inventorier et articuler les initiatives existantes. « Il y a une réelle opportunité de passer de dix ans de discussion sur la transition juste à une mise en œuvre concrète », explique Gaïa Febvre, responsable des politiques internationales au Réseau action climat France. Aujourd’hui, la transition juste est extrêmement fragmentée et la partie « juste » de la transition disparaît ». Malgré un accès au logement à Belém d’une iniquité poussée à l’absurde, la société civile a donné rendez-vous le 15 novembre dans les rues de la capitale du Para.
Le Brésil est également un monstre sur le plan agricole, aux dépens de sa forêt, et le huitième pays producteur d’or noir. Il est une puissance émergente qui incarne, tel l’âne de Buridan, le tiraillement entre la lutte contre le changement climatique et le désir d’exploiter ses lucratives mais délétères ressources fossiles pour financer le développement économique. Sauf que Lula da Silva n’est pas cet animal allégorique qui se laisse mourir faute de choisir entre le seau d’eau et le seau d’avoine. L’ancien syndicaliste, passé par la case présidentielle à trois reprises et celle de la prison, a choisi d’autoriser, à deux semaines de la COP, l’exploration pétrolière au large de l’embouchure de l’Amazone. La bronca est mondiale depuis, et les responsables brésiliens, eux-même divisés, sont poussés à justifier cet affront au climat. « C’est une contradiction, reconnaît Tulio Andrade, le directeur stratégique de la COP. Mais il y a différentes façons de transitionner. Avant de changer de maison, il faut en construire une nouvelle. Il faut construire une nouvelle économie. »
Le nœud gordien du financement
D’autres pays détenteurs de ces ressources sont tentés les extraire pour s’enrichir. Car pendant ce temps, le nœud gordien du financement vers les pays du Sud n’est toujours pas défait.
A l’issue de la COP29, les États se sont accordés sur un nouvel objectif de 300 milliards de dollars pour la transition et l’adaptation au changement climatique. Une somme que les pays industrialisés, historiquement responsables de la concentration de CO2 dans l’air, devront verser chaque année d’ici à 2035 aux pays du Sud. « Cet accord a laissé un goût amer aux pays en développement », expose Lorelei Limousin, chargée du dossier finance à Greenpeace, tant il est décorrélé des nécessités.
Ces pays ont donc demandé, lors de la COP29, à recevoir 1000 milliards de dollars de plus par an. La « feuille de route de Bakou à Belém », publiée hier, devait fixer les moyens d’y parvenir. Meilleure coordination financière, allègements de dettes, rôle du privé et des banques de développement mais aussi des taxes : « les outils sont prêts », assurent les présidents des COP29 et 30, l’Azerbaïdjanais Moukhtar Babaïev et le Brésilien André Correa do Lago.
Les solutions n’ont rien de novateur, déplorent de leur côté les ONG. « On se demande ce que les Etats vont pouvoir faire avec cette feuille de route. Les deux seuls points concrets sont une série de dialogues l’année prochaine pour discuter de sa mise en œuvre et un groupe d’experts indépendants », décrypte Rebecca Thissen, spécialiste finance au Climate Action Network. Déçue également, Greenpeace relève toutefois « un signal positif » sur « la taxation des entreprises de combustibles fossiles (qui) apparaît clairement comme la solution pour surmonter les contraintes budgétaires nationales », salue Rebecca Newsom. Un impôt sur les plus grandes fortunes pourrait rapporter entre 200 et 1364 milliards de dollars selon les taux appliqués, indique le rapport. Sur l’aviation ou le transport maritime, cela rapporterait quant à elle de 4 à 223 milliards de dollars, et une taxe sur les transactions financières entre 105 et 327 milliards de dollars.
Ce sujet atomique du financement irradie tous les autres. Il sera sous-jacent à l’évaluation des progrès nationaux pour l’adaptation (Objectif mondial d’adaptation) à travers 100 indicateurs concrets qui doivent être discutés voire adoptés. De plus, l’engagement pris à Glasgow, lors de la COP27, de doubler le financement public international à 40 milliards annuels pour l’adaptation avant 2025 arrive à expiration. Dans son rapport annuel sur l’adaptation, l’ONU estime qu’il manque entre 310 et 365 milliards par an à destination du Sud.
A cette COP, « il ne faut pas s’attendre à des accords sur des gros sujets clinquants », selon Marta Torres-Gunfaus, chercheuse sur le climat à l’Iddri. Au Stockholm Environment Institute, Richard Klein abonde : « Le sentiment d’urgence grandit chaque année, mais il est peu probable que cette urgence se reflète dans les résultats de la COP30. »
Plusieurs experts, comme la climatologue Valérie Masson-Delmotte, espèrent voir l’avis historique de la Cour internationale de Justice (CIJ), émis en juillet, cité dans le document final. La haute cour stipule que l’action climatique est désormais une obligation juridique pour les Etats. « A un moment où de nombreux pays renoncent à leurs engagements », conclut Richard Klein, « une telle référence soulignerait que l’inaction face au changement climatique peut avoir des conséquences ».
Avec AFP
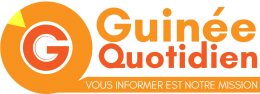 Guinée Quotidien Bienvenue sur Guineequotidien, notre mission est de vous informer
Guinée Quotidien Bienvenue sur Guineequotidien, notre mission est de vous informer






